
Pouvez-vous
nous rappeler pourquoi le GEST a été créé en 1995 ?
Il y avait alors
une vraie problématique de compréhension des sols et on voulait approfondir les
notions de matière organique, de vie du sol, de terroir… Dès le départ, nous
avons rencontré Claude Bourguignon pour travailler sur la microbiologie des
sols et Yves Hérody pour aborder les questions liées à la géologie des sols.
La longue
histoire bourguignonne est largement basée sur la notion de terroir, alors vous
voulez dire qu’en 1995 les vignerons bourguignons ne connaissaient plus leurs
sols ?
Pendant toute la période allant des années
1960 aux années 1990, beaucoup ont pratiqué une viticulture intensive et ils
ont oublié l’existence du sol, en particulier avec la généralisation des
désherbages chimiques. On redécouvre en effet aujourd’hui que les anciens
avaient de bonnes pratiques et une compréhension fine de ce qui se passait dans leurs vignes. Nous
cherchons désormais à aller plus loin, à approfondir ces questions. On est en
effet en train de comprendre que chaque terroir est unique et à chaque terroir correspondent de bonnes et de
mauvaises pratiques viticoles. À
partir de là, le GEST a développé au fil du temps des cartes géologiques
comme celle de la Colline
des Cortons qui
permettent d’adapter les pratiques aux différents types de sols.
Il y a une
vingtaine d’années, Claude Bourguignon, microbiologiste des sols,
assurait que les sols bourguignons
étaient aussi vivants que ceux du Sahara. La situation s’est-elle
améliorée ?
Énormément. 15 % des
vignes sont aujourd’hui cultivées en bio en Côte-d’Or, près de 10 % pour
toute la Bourgogne ;
c’est énorme. Tout le monde aujourd’hui commence à parler de gestion organique du sol et les engrais
chimiques ne sont quasiment plus utilisés. En outre, on revoit partout de
l’enherbement dans les vignes, ce qui est un élément indispensable à la
diversité. La viticulture se repose les bonnes questions.
L’accumulation
du cuivre dans les sols est souvent dénoncée par ceux qui critiquent la
viticulture bio. Qu’en pensez-vous ?
C’est bien
leur seul argument.
Un argument de
poids quand même…
Non, car on a
le contre-exemple des sols du Keuper, une formation géologique que l’on trouve
dans le Jura et en Alsace, qui ont naturellement 1 000 fois la dose de
cuivre que l’on a dans un sol normal et ce sont pourtant de grands terroirs
viticoles. Quand j’ai débuté dans les années 1970, on prenait des sacs de
bouillie bordelaise, du cuivre neutralisé
à la chaux, sur lesquels était marqué : dose d’utilisation à l’hectare, 12
à 15 kg
par traitement ! J’étais descendu à 8 kg. Aujourd’hui, on traite entre 0,5 et 2 kg et on essaie d’être
à moins de 5 kg
de cuivre-métal par an, ce qui ne pose pas de problème pour les sols ; le
cuivre fait partie du vivant, les plantes l’utilisent. Mais cela signifie qu’il
était donc déjà possible il y a quarante
ans d’utiliser le dixième des doses alors recommandées par des firmes qui ne cherchaient
qu’à vendre le maximum de produit. C’est à ce moment-là que l’on a créé d’énormes accumulations
de cuivre dans les sols, mais ce ne sont pas les vignerons les
responsables ; ce sont les marchands de produits.
Vous parlez
beaucoup de la notion de « vie du sol » qui reste quand même assez
abstraite. Pouvez-vous expliquer très simplement ce qu’est la vie microbienne
d’un sol et qu’est ce qui fait qu’un sol est « vivant » ?
Le sol est
l’un des mondes les plus complexes qui existent. Il abrite une multitude de
petits animaux qui dégradent la matière organique, mais aussi un monde de
champignons essentiels à la vigne ; on trouve également des bactéries, des
algues… Tout ceci fait partie de la notion de terroir, car à chaque sol
correspond une vie microbienne spécifique. Alors si tous ces éléments sont
actifs, la vigne va trouver un milieu favorable pour fabriquer cette expression
du terroir que l’on veut trouver dans un vin.
Combien de
temps faut-il à un sol pour retrouver de la vie ?
Cela va
dépendre de l’état du sol et des pratiques mises en place, mais disons qu’il
faut trois à sept ans. Avec
l’enherbement, on peut
aller vite, car en saison hivernale, l’herbe est un soutien à la vie microbienne. Les apports de
compost sont extrêmement importants pour relancer la vie du sol. Pour ceux qui
pratiquent la biodynamie, les préparations vont être des stimulants.
Rien n’est
irréversible ?
Rien n’est
jamais irréversible. La nature est puissante.
Vous pouvez lire l’intégralité de l’interview en vous abonnant ou en achetant le numéro 128 de Bourgogne Aujourd’hui et son supplément Beaujolais Aujourd’hui n°16.

14 mars 2024

05 mars 2024

28 février 2024
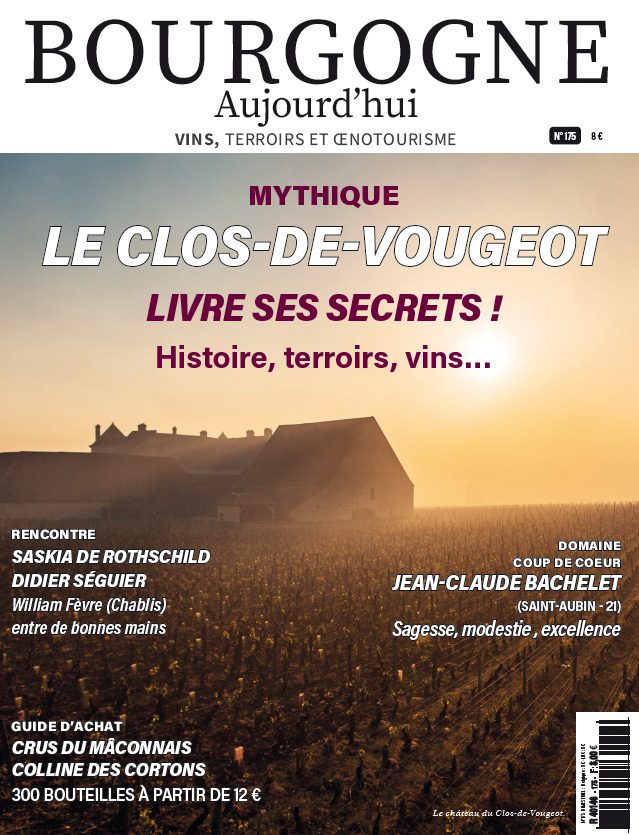
BA175
Actualités
Évènement
la Bourgogne manque de bras ?
Rencontre
Saskia de Rothschild et Didier Séguier
William Fèvre entre de bonnes mains
Guide d’achat/dégustations
Appellation
Colline des Cortons
Un vignoble singulier, complexe… et passionnant
Guide d’achat
Appellation
Mâconnais
Des premiers crus pour tous ?
Guide d’achat
Domaine Coup de coeur
Jean-Claude Bachelet
Sagesse, modestie et excellence
Débat
Élevage sous bois et sans bois
Dossier
Les terroirs du Clos-de-Vougeot
Gastronomie
En cuisine avec Stéphane
Le pot-au-feu
Bourgogne Aujourd’hui n°175

BA 174
Actualité/évènement
Saint-Vincent-Tournante 2024
Morey-Saint-Denis - Chambolle-Musigny
Guide d’achat / dégustations
Vins de l’Yonne
Bourgognes-Mâcons
Dossier
Palmarès de l’année 2023
Les bourguignons de l’année
Gastronomie
Kévin Julien
Éloge de la rigueur
Cahier
Crémant de Bourgogne
Bourgogne Aujourd’hui n°174
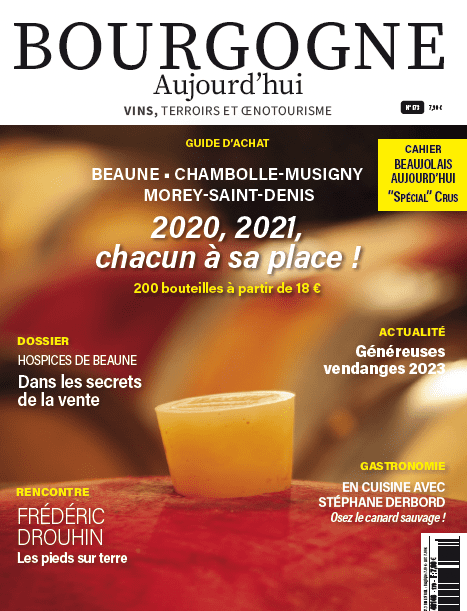
BA173 - sommaire
Rencontre
Frédéric Drouhin
Les pieds sur terre
Premier millésime
Domaine des Jeunes Pousses
Thais et Juliette
au fil de la vigne
Guide d’achat / dégustations
Chambolle-Musigny, Morey-saint-denis
Si proches et si différents
Guide d’achat
Beaune
conformes aux attentes
Guide d’achat 34
Dossier
Hospices de Beaune
Dans les secrets de la vente
Cahier beaujolais
Spécial crus
Bourgogne Aujourd’hui n°173

Actualités
En bref 4
dossier
Cité des Climats et des Vins de Beaune
Plongez au coeur des Climats
et des Vins de Bourgogne 6
Guide d'achat / dégustations
Dossier
spécial millésime 2022
Proche des sommets 19
Yonne 27
Côte de Nuits 34
Côte de Beaune 53
Côte Chalonnaise 87
Mâconnais 94
Gastronomie
Bonnes adresses 99
La Côte Saint-Jacques
succession en douceur
et dans la bonne humeur 100
Au fil des pages 104
Bourgogne Aujourd’hui n°172